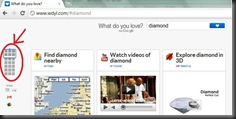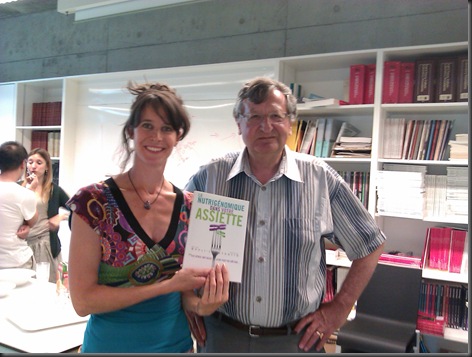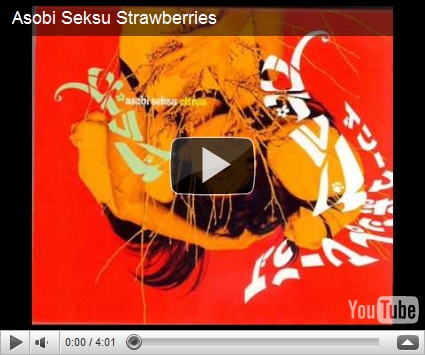Il y a quelques jours je faisais des recherches sur internet et je suis tombée presque par hasard sur “
Propre en Ordre”, un livre écrit par Geneviève Heller et publié à Lausanne en 1979. Commençant par se demander comment la légendaire propreté suisse a été socialement construite, cet ouvrage présente une histoire sociale de la vie domestique dans le canton de Vaud couvrant la période entre 1850 et 1930. Il s’agit d’un livre extrêmement bien documenté, qui présente avec un langage assez simple tous les bouleversements intervenus dans la vie de tous les jours au tournant du siècle dernier.
On voit ainsi apparaître progressivement les machines à vapeur, les laveries collectives, les réseaux de gaz, d’eau et d’électricité qui envahissent les rues et les foyers. Comme
Foucault nous l’a appris, ceci ne se fait bien évidemment pas sans l’intervention des
disciplines scientifiques, d’abord et avant tout l’hygiène. Ainsi, l’auteur nous présente les propos et les oeuvres de plusieurs hygiénistes suisses et en particulier lausannois et la manière dont ils ont fait évoluer les moeurs (par exemple pour ce qui concerne les bains dans le lac). Les médecins et les “services sociaux” de l’époque apparaissent comme les grands inventeurs et propagateurs de la propreté en Suisse: on nous décrit non seulement les avancées théoriques, mais aussi la surveillance pratique exercée au quotidien sur la population (par exemple à l’école) et la lente évolution des habitudes. C’étaient bien les débuts de la
biopolitique! En même temps, des intérêts politico-économiques ont poussé pour le passage de la saleté à la propreté. A une époque où des maladies telle la tuberculose étaient très diffuses et la Suisse se définissait en tant que lieu touristique thérapeutique et sain (
exemple), la propreté apparût comme un élément fondamental pour garder cette connotation. En effet, l’hygiène impeccable des établissement et des villes attrayait les touristes, mais il empêchait aussi aux germes de se propager (c’étaient les années des découvertes de
Pasteur). En plus, l’amélioration des conditions de vie des ménages populaires était soutenue par les milieux aisés, puisqu’elle calmait les esprits et éloignait la menace communiste.
Ces phénomènes ont certes été décrits dans plusieurs ouvrages, mais il y a plusieurs raison de lire celui-ci. Premièrement il intègre beaucoup de références, de citations, d’images et il permet non seulement de se faire une idée claire des événements, mais aussi de les visualiser grâce aux photos et aux gravures reproduites. En outre, il se focalise presque complètement sur Lausanne et ses environs, donc il fait voyager ses lecteurs dans une autre époque, où la ville elle-même était différente. Enfin, il ne faut pas se déplacer pour l’avoir (!): la version intégrale est disponible en ligne et peut être téléchargée gratuitement en format .pdf (voir l’image).

Si vous voulez vous distancier de tous les conforts dont notre époque nous fait profiter, prendre du recul, et réaliser que certains instruments et quelques habitudes sont plutôt récents (que sont cent ans à l’échelle de l’humanité?), cet ouvrage est fait pour vous!
Voici quelques passages qui m’ont beaucoup plu:
Deux lanternes à gaz étaient allumées, Place de la Riponne, le 31 décembre 1846! Presque partout l’on choisissait les fêtes de fin d’'année, la nuit de la Saint-Sylvestre particulièrement, pour introduire les premiers éclairages publics, à gaz puis électriques. Lausanne n’était alors éclairée que par une dizaine de falots à huile accrochés à un câble tendu entre les maisons. Frédéric Loba, un chimiste, venait de recevoir de la commune de Lausanne le monopole de l’éclairage au gaz public et privé. Constituée en société privée, son entreprise installa en 1848 sa première usine à gaz au port de Lausanne, à Ouchy. “Le samedi 22 janvier 1848, on vit le Bazar vaudois éclairé par une vingtaine de becs d’espèces différentes, qui attirèrent la visite d’une foule de curieux. La place de la Palud fut éclairée au gaz quelques jours après, et les rues ne tardèrent pas à être dotées de nouveaux réverbères (…) Puis divers établissements publics et des magasins (…) C’était l’âge d'or de la compagnie; chacun admirait cette flamme sans mèche qui s’étalait aux yeux sous la forme d’un papillon” [page 47]
La plus éclatante, la plus blanche enfin, presque comme le soleil! Non pas jaune comme les lampes habituelles. “Non seulement elle n’altère pas les couleurs des tissus ou autres objets, mais nous les montre comme la lumière du jour, sous leur véritable aspect.” Cette qualité fut d’ailleurs la seule qui lui fut nuisible pendant un certain temps: on craignait de s’abîmer les yeux, de les brûler à la longue en vivant sous un éclairage si éclatant. Le préjugé était plus fort que la réalité, l’ampoule habituelle était alors de 20 watts! Enfin, l’électricité, auréolée d’une puissance quasiment miraculeuse, devait susciter des commentaires lyriques: “Combien de fois n’avons-nous pas admiré, des hauteurs, la plaine qui s’étend au loin, toute parsemée de constellations. Ce sont les villes et les villages éclairés à l’électricité. Ne dirait-on pas vraiment que cette fée, en parcourant monts et vallées, dans une chevauchée désordonnée, a pris plaisir à laisser tomber de son chariot lumineux quelques fleurs aux brillantes couleurs.” [pages 50-51]
Suite à la lecture de cet ouvrage, j’ai décidé de poursuivre mes promenades dans la Suisse d’un temps avec un petit livre (d’ailleurs cité par Heller à la page 208), “
Pipes de terre et pipes de porcelaine”, qui recueille les souvenirs de Madeleine Lamouille, femme de chambre en Suisse romande entre 1920 et 1937, tels que recueillis par Luc Weibel. Cet ouvrage d’histoire orale en réalité commence bien avant 1920, avec l’enfance de madame Lamouille au début de 1900, dans un petit village du canton de Fribourg. Ils nous raconte l’histoire d’une famille pauvre, d’un pays très inégalitaire et profondément différent de celui qu’on connait aujourd’hui. Après avoir été ouvrière en France, la protagoniste revient en Suisse et elle commence à travailler comme gouvernante chez des familles aisées de la Suisse romande, chose qu’elle fera jusqu’à son mariage. Les scènes répertoriées dans ces récits sont touchantes et dramatiques; beaucoup d’entre elles seraient impensables dans la société suisse contemporaine. Le monde qu’on nous décrit est dur, classiste, épouvantable. Il s’agit, en somme, d’un magnifique témoignage qui laisse révoltés, mais aussi satisfaits du progrès que des personnes comme madame Lamouille ont construit et ont offert aux générations actuelles.
Plus ou moins entre 1915 et 1919, on retrouve les deux premières scènes que je vais citer plus bas. Je les ai lues dans un moment banal, assise à un arrêt de bus bien propre, en attendant un bus ponctuel, avec des habits neufs, un bon petit déjeuner dans le ventre et, aux oreilles, un iPod qui chantait la chanson que vous trouvez ci-bas. Ce que je vous propose, c’est de faire partir la vidéo et de lire les quelques lignes qui suivent…peut-être en vous disant qu’en vivant de nos jours, dans nos pays, on a quand même vraiment de la chance. Bonne route!