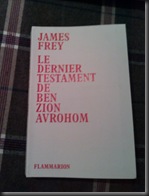En vacances j’ai finalement le temps de lire un peu…et, si je considère les livres qui attendent d’être feuilletés, je n’ai que l’embarras du choix. Puisqu’il faut bien commencer quelque part, j’ai choisi “La religieuse”, une œuvre réalisée à la fin du XVIIIe siècle par Denis Diderot et devenue désormais un classique de la littérature française.
Diderot, Denis (2000) La religieuse. Paris: Librairie Générale Française, 319 pp.
|
|  Portrait de Denis Diderot, par Louis-Michel Van Loo (1767) Portrait de Denis Diderot, par Louis-Michel Van Loo (1767) |
 Marc-Antoin-Nicolas de Croismare dans une gravure de Charles-Nicolas Cochin Marc-Antoin-Nicolas de Croismare dans une gravure de Charles-Nicolas Cochin | Il s’agit d’une œuvre dont la réalisation est drôle et bizarre. Diderot et son entourage avaient un ami, le marquis de Croismare, qui avait quitté Paris et était parti à la campagne pour quelques temps; pour le convaincre à retourner dans la capitale, Diderot et ses amis avaient imaginé une histoire assez alambiquée. |
En effet, quelques temps auparavant, ledit marquis s’était intéressé à l’histoire d’une bonne sœur qui, se plaignant du fait que ses vœux lui avaient été extorqués, essayait de quitter son ordre et de reprendre une vie séculaire. Une fois que le marquis quitta Paris, Diderot commença à lui envoyer des lettres se faisant passer pour la bonne sœur, qui se serait enfuie du couvent et demanderait de l’aide au marquis lui-même. Le marquis tomba dans le piège, en offrant de l’aide à la jeune femme. Cependant, quand il proposa qu’elle le rejoigne à la campagne, Diderot essaya d’abord de prendre du temps, en faisant tomber malade la fantomatique religieuse, et ensuite il décida de la tuer.
Le roman se compose de deux parties: une partie contient la vraie correspondance entre le marquis de Croismare et “la religieuse” (soit Diderot) et une autre partie, bien plus longue, contient des mémoires que “la religieuse” avait rédigées à l’intention du marquis juste avant de mourir. Ce sont ces mémoires qui représentent le cœur de l’ouvrage.
La religieuse Suzanne Simonin est le personnage principal, et aussi l’unique narrateur, du moins dans la partie des mémoires (puisque dans la correspondance on trouve aussi le marquis, une fantomatique dame qui aurait assisté la “religieuse” et Diderot lui-même, qui présente le récit).
Elle explique son histoire d’enfant illégitime, placé de force au couvent pour ne pas porter préjudice aux enfants légitimes (ses demies-sœurs). Une fois au couvent, elle rencontrera plusieurs personnages usés et névrosés par la vie communautaire, et tout particulièrement ses mères supérieures.
Diderot avait l’expérience des méfaits de la vie religieuse, puisque sa sœur était devenue folle et morte au couvent, et li avait lui aussi été enfermé au couvent pendant sa jeunesse; il profite donc du monologue de Suzanne pour s’élever contre les perversion que la vie monastique instille dans l’âme des gens - et cela, bien évidemment, depuis son point de vue d’homme des Lumières.
Ainsi, Suzanne rencontre d’abord une mère supérieure “illuminée”, en proie à des délires mystiques et qui s’auto-convainc d’avoir la foi et une relation privilégiée avec Dieu. Suite à sa mort par folie, causée par une crise spirituelle, Suzanne connait un deuxième couvent et une deuxième mère spirituelle: elle est sadique et superstitieuse, et elle mortifie la chair et le corps des bonnes sœurs à l’aide du cilice et d’autres instruments. Finalement, ayant appelé l’évêque au secours, Suzanne réussit à migrer vers un troisième couvent et là elle connait sa troisième mère supérieure, qui s’entoure d’un véritable harem de jeunes nonnes et essaye de séduire la naïve héroïne. Quand finalement elle s’enfuit, elle doit se cacher mais elle goute un petit peu à la liberté, bien que seulement pour une très courte durée: elle tombe malade et elle meurt peu après (faute de pouvoir rejoindre le marquis à la campagne en chair et en os!).
L’œuvre peut être analysée à plusieurs niveaux. Tout d’abord, la qualité de la narration est excellente: les descriptions sont abondantes et touchantes, mais jamais excessives; les dialogues permettent à d’autres personnages de prendre la parole, et enrichissent le nombre de points de vue présents dans le roman; finalement, les réflexions de Suzanne permettent à Diderot de se manifester lui-même et d’exprimer ses idées philosophiques anticléricales et libertaires.
Ces réflexions prêtées à Suzanne la caractérisent comme un personnage particulièrement complexe. Si elle possède presque entièrement des caractéristiques que Diderot et les hommes de l’époque considèrent exclusivement féminines (elle est volubile, irrationnelle, naïve, fragile), elle a parfois des moments de lucidité et d’extrême rationalité…qu’elle n’ose toutefois pas assumer jusqu’au bout, et en tout cas jamais sans un support masculin. Pour cette raison, le roman n’est pas seulement une belle œuvre de fiction, mais aussi une bonne source pour analyser la construction sociale du genre.
| Diderot ne nous fournit cependant pas seulement de la matière sur le genre, mais aussi sur la construction sociale de la sexualité. En effet, toute une partie des mémoires de Suzanne contient la description minutieuse de ce que Michel Foucault et d’autres auraient identifié, deux siècles plus tard, comme la surveillance et la disciplinarisation des corps (voir ici par exemple). En effet, quel meilleur endroit que les couvents pour dresser les corps et les surveiller? | Plan du Panoptique par Jeremy Bentham. Il s’agit du modèle idéal de structure de surveillance à la fin du XVIIIe siècle |
Ce processus va plus loin que le corps, jusqu’à pénétrer l’esprit des surveillés par une microphysique du pouvoir, à l’œuvre dans des dispositifs (ou devrait-on les appeler des rituels) tels l’aveu, la confession etc. Or, dans le roman de Diderot, on observe ces mécanismes en action: par exemple, l’aveu sur l’adultère de sa mère, opportunément filtré par les hiérarchies religieuses, convainc Suzanne à rentrer au couvent; ce sont encore des aveux sur la nature des sentiments de la mère supérieure qui mettent en discussion leur relation, après avoir été analysés et disséqués par des tierces personnes.
Ces étapes vers l’aveu, la médiation d’un expert (confesseur ou autre) et l’introspection médiatisée par les instruments de l’experts (par exemple par les notions religieuses) sont exactement celles décrites par Michel Foucault dans Histoire de la Sexualité I: La volonté de savoir (pour avoir un résumé de ce livre agrémenté de citations, écrivez-moi)… Et ce n’est sans doute pas un hasard si “La religieuse” est l’une des sources sur lesquelles Foucault s’appuie pour construire sa théorie sur la construction sociale de la sexualité!
Tout en s’inspirant du romancier anglais Samuel Richardson, qu’il admire, Diderot mène aussi un discours anticipateur des fondements des sciences sociales. En effet, Diderot ne dénigre et ne se moque pas de la religion ou d’autres comportements qu’il juge irrationnels (et d’autant plus lointains de on point de vue qu’il est pleinement intégré dans les Lumières): il essaye de les comprendre (même si ce n’est que pour mieux les combattre), dans une démarche qui n’est pas sans rappeler la sociologie compréhensive de Max Weber.
Diderot donc ne se contente pas d’écrire un roman: il veut raconter comment certains parcours individuels sont, au final, socialement construits. Il ne veut pas imposer son point de vue de philosophe de manière déconnectée de la réalité, mais il exploite un récit vraisemblable pour rendre la réalité intelligible au lecteur et ainsi faire mieux accepter sa réflexion philosophique. Pour ce faire il maquille la réalité de manière consciente, et il le revendique. Puisqu’on a déjà traité de la limite entre la réalité et la fiction dans la création littéraire quelques temps en arrière, il me semble intéressant de reporter ici quelques propos de Diderot lui-même à ce propos:
“Le monde où nous vivons est le lieu de la scène; le fond de son drame est vrai; ses personnages ont toute la réalité possible; ses caractères sont pris du milieu de la société; ses incidents sont dans les moeurs de toutes les nations policées; les passions qu’il peint sont telles que je les éprouve en moi; ce sont les mêmes objets qui les émeuvent, elles ont l’énergie que je leur connais; les traverses et les afflictions de ses personnages sont de la nature de celles qui me menacent sans cesse; il me montre le cours général des choses qui m’environnent. Sans cet art, mon âme se pliant avec peine à des biais chimériques, l’illusion ne serait que momentanée, et l’impression faible et passagère.” (p. 292)
“Au diable le conte et le conteur historiques! c’est un menteur plat et froid. – Oui, s’il ne sait pas son métier. Celui-ci se propose de vous tromper; il est assis au coin de votre âtre; il a pour objet la vérité rigoureuse; il veut être cru; il veut intéresser, toucher, entrainer, émouvoir, faire frissonner la peau et couler les larmes; effets qu’on n’obtient point sans éloquence et sans poésie.” (p. 295)
En somme, il s’agit d’un ouvrage beau, riche et enrichissant, et particulier, dont je vous recommande vivement la lecture. Pour avoir un aperçu de ce que vous allez trouver en le feuilletant, en voici un extrait.
“Je m’arrangeai dans ma cellule; j’assistai à l’office du soir, au souper, à la récréation qui suivit. Quelques religieuses s’approchèrent de moi, d’autres s’en éloignèrent; celles-là comptaient sur ma protection auprès de la supérieure; celles-ci étaient déjà alarmées de la protection qu’elle m’avait accordée. Ces premiers moments se passèrent en éloges réciproques, en questions sur la maison que j’avais quitté, en essais de mon caractère, de mes inclinations, de mes gouts, de mon esprit; on vous tâte partout; c’est une suite de petites embuches qu’on vous tend, et d’où l’on tire les conséquences les plus justes. Par exemple, on jette un mot de médisance, et l’on vous regarde; on entame une histoire, et l’on attend que vous en demandiez la suite, ou que vous la laissiez; si vous dites un mot ordinaire, on le trouve charmant, quoiqu’on sache bien qu’il n’en est rien; on vous loue ou l’on vous blâme à dessein; on cherche à démêler vos pensées les plus secrètes; on vous interroge sur vos lectures; on vous offre des livres sacrés et profanes; on remarque votre choix; on vous invite à des légères infractions à la règle; on vous fait des confidences, on vous jette des mots sur les travers de la supérieure: tout se recueille et se redit; on vous quitte, on vous reprend; on sonde vos sentiments sur les mœurs, sur la piété, sur le monde sur la religion, sur la vie monastique, sur tout. Il résulte de ces expériences réitérées une épithète qui vous caractérise, et qu’on attache en surnom à celui que vous portez; ainsi je fus appelée Sainte-Suzanne la réservée.” (pp. 169-170)
Pour nous quitter, voici une chanson que j’aime bien et où il est fait mention d’une bonne sœur ainsi que d’une mère supérieure (pas facile de trouver de chansons sur le sujet!): Vertige de l’amour du français Alain Bashung. Bonne route!